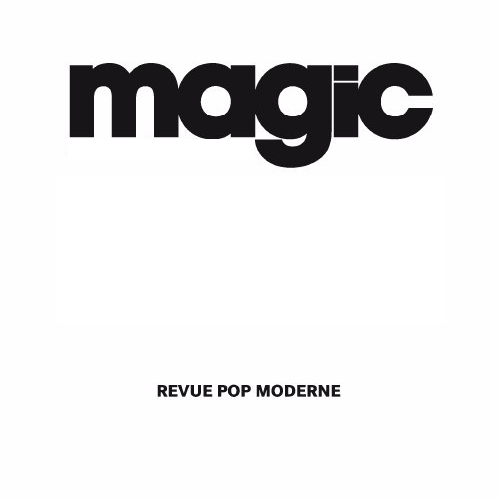Very Good Bowie Trip : au cœur des métamorphoses
David Bowie n’a jamais cessé de se transformer. Artiste caméléon, figure de liberté et observateur visionnaire de son époque, il continue d’influencer profondément la musique contemporaine. À travers Very Good Bowie Trip, le journaliste musical Michka Assayas revient sur l’œuvre de Bowie, les métamorphoses successives et l’héritage durable qu’il a laissé dans le rock et la culture pop.
Vous écrivez au début du livre que vous n’étiez pas particulièrement fan de David Bowie. Est-ce que le fait d’écrire Very good Bowie trip a changé votre regard sur lui ?
Oui, complètement. J’avais vis-à-vis de Bowie de vieux préjugés qui remontaient à mon adolescence, à un âge où l’on se forge des opinions toutes faites sur beaucoup de choses. Lorsque j’ai travaillé sur Le Dictionnaire du rock, par exemple, il y avait déjà de nombreux groupes et chanteurs sur lesquels j’avais ce type d’idées reçues et, en creusant, en écoutant réellement les disques, je me suis rendu compte que j’étais complètement passé à côté.
Avec David Bowie, c’est encore plus frappant. En écrivant le livre, j’ai pris conscience de l’incroyable richesse musicale et de la complexité de son œuvre, que je réduisais trop souvent à une simple construction d’image, à une approche froide et calculée de la musique. Je m’étais en réalité arrêté à la surface des choses, notamment à cette voix très théâtrale, qui n’était pas celle d’un chanteur de rock mais plutôt d’un chanteur de music-hall, et qui m’indisposait un peu.
En me plongeant dans sa discographie bien des années plus tard, j’ai réalisé à quel point les groupes que j’aimais lui devaient beaucoup, en particulier Joy Division. Cela a totalement transformé ma perception et mon appréciation de David Bowie.
Comment est née l’idée de Very good Bowie trip ? Était-ce un projet de longue date ou un besoin soudain d’écrire après la mort de David Bowie ?
C’est en réalité une commande du directeur de la musique de France Inter. Nous nous interrogions sur la série à proposer pour l’été et il m’a suggéré Bowie. Au départ, je ne me sentais pas assez légitime, puis j’ai finalement accepté sa proposition. Cela a été l’occasion pour moi de découvrir sa carrière.
Comment avez-vous travaillé la mémoire : avec des archives, des notes d’époque, ou à partir du souvenir brut ?
Comme pour mes émissions de radio, c’est un peu un mélange de tout cela. Il y a d’abord le souvenir brut, que je peux parfois raconter tel quel, mais dans le cas de Bowie, cela n’allait pas très loin, car mes souvenirs étaient très épars. Ensuite, je me documente à partir de sources solides, comme des biographies ou des magazines, et il y a aussi énormément de choses disponibles sur Internet.
Bowie avait cette aptitude à deviner, à capter son époque par des ondes presque poétiques
Est ce que le titre aurait pu s’appeler Very good bowies trip tant cet artiste n’a cessé de se transformer tout au long de sa carrière ?
Il a effectivement fait plusieurs voyages dans sa vie d’artiste. Bowie s’est d’abord fait connaître comme l’artiste du rock décadent, mettant en avant l’ambiguïté sexuelle et le travestissement : c’était la période Ziggy Stardust. Et, à la stupeur de son public, il a “tué” ce personnage sur scène pour revenir sous une autre identité : le Thin White Duke. Il a ensuite encore multiplier les personnages pour s’effacer presque complément pendant sa période Berlinoise. On peut faire l’analogie avec la transformation de Bob Dylan, telle qu’elle est évoquée dans le film Un parfait inconnu de James Mangold, qui montre cette mise à mort de son personnage de chanteur politiquement engagé pour partir dans une toute autre direction, celle du rhythm and blues électrique et d’une approche beaucoup plus individualiste de la musique. C’est tout ce parcours qui m’a captivé : Bowie, c’est un peu comme un comédien qui invente à chaque fois le nouveau film dans lequel on va le redécouvrir.
David Bowie a souvent brouillé les frontières entre art et identité. Qu’est-ce qui, chez lui, vous semble le plus “moderne” ?
Il a été le premier à introduire dans le rock une théâtralité très élaborée, qui ne passait pas seulement par les costumes, mais aussi par la gestuelle, par cet aspect très chorégraphique. Ce qu’il a apporté de profondément moderne, c’est cette perte de repères, cette crise de l’identité, et la tentative d’exister en expérimentant différents personnages, différents masques, parce qu’il y a quelque chose qui vous échappe, une sorte de vide, de béance intérieure.
David Bowie a parfois été accusé d’opportunisme, de s’approprier les styles, les sons ou les esthétiques du moment. Pensez-vous que cette critique est juste ?
Opportuniste, je pense que tout artiste qui rencontre le succès l’est forcément à un moment donné, parce qu’il faut savoir surfer sur une vague. L’un des reproches qui lui ont été faits est d’avoir été une sorte de “vampire”, qui se nourrissait du travail des autres avant de les abandonner. Je ne sais pas si c’est vrai, mais ce qui est sûr, en revanche, c’est qu’il a été généreux dans sa manière de s’approprier l’art des autres, que ce soit vis-à-vis d’Iggy Pop ou de Lou Reed, par exemple.
C’est d’ailleurs le cas de beaucoup d’artistes, qui aspirent la substance de créateurs qu’ils trouvent passionnants, nouveaux, capables de capter quelque chose qu’eux-mêmes n’ont pas encore saisi. Bowie était avant tout un immense fan de musique, toujours désireux d’écouter ce qui se faisait de nouveau et de comprendre son époque. Il y a cependant une période qu’il a lui-même reniée : celle qui a suivi Let’s Dance. C’est un disque qu’il a financé sur ses fonds propres et dont il avait besoin qu’il soit une réussite commerciale. Il s’est alors entouré de Nile Rodgers, qui traversait lui aussi un creux de vague. L’album a rencontré un succès bien au-delà de ses espérances, et Bowie s’est retrouvé soumis à une pression inédite de la part de sa maison de disques pour produire un Let’s Dance numéro deux, qui s’est finalement avéré être l’album Tonight.

Avez vous déjà rencontré Bowie ?
Malheureusement, il n’y en a pas eu. Et je pense d’ailleurs que, même si j’avais eu l’occasion de le rencontrer, cela n’aurait sans doute pas donné une interview très intéressante pour le lecteur. Une bonne interview doit être nourrie par une connaissance approfondie et un véritable attachement, et comme je n’avais pas ressenti grand-chose à son égard à l’époque, je n’aurais probablement pas été un interlocuteur pertinent.
En tant que journaliste et observateur du rock, comment percevez-vous l’héritage de Bowie dans la musique d’aujourd’hui ?
Aujourd’hui, peut-être un peu moins qu’il y a quarante ans, notamment à l’époque de l’après punk. Mais dans les années 1990, on peut citer Blur, qui a repris une partie de l’héritage de Bowie, ainsi que Arcade Fire ou encore LCD Soundsystem qui sont fans de l’artiste. Quoi qu’il en soit, dès que l’on parle avec des musiciens qui connaissent bien l’histoire de la musique, le nom de Bowie arrive très vite sur la table.
Le livre parle aussi d’une époque, d’une génération. Pensez-vous que Bowie symbolise un certain rapport à la liberté qui peut sembler aujourd’hui un peu disparu ?
Complètement. Aujourd’hui, la liberté n’est plus vraiment en vogue. Il y a eu des excès, on en parle beaucoup, et on assiste à une période de règlements de comptes en partie justifiée. Mais il semble désormais presque inadmissible d’aller explorer des territoires qui ne sont pas balisés par la morale sans se faire immédiatement critiquer. Et il manque des artistes de la dimension de Bowie, avec cette folie et cette liberté. Le monde actuel ne favorise pas vraiment cela, même si l’on peut espérer que cela revienne.
En 1997, Bowie déclarait : “Avec Internet, la musique va devenir comme l’eau courante ou l’électricité.” Il a été le premier à diffuser un concert en ligne, à créer son propre site web. Peut-on dire qu’il avait perçu avant tout le monde la révolution numérique ?
Il a perçu beaucoup de choses à l’avance, ce qui est assez extraordinaire. Il a aussi incarné très tôt les questions de genre, quel génie d’avoir compris cela si tôt. Bowie était par ailleurs très affecté par la désacralisation de la musique, et c’est quelque chose que je ressens également fortement. J’ai toujours été fasciné par la dimension presque mystique qui entoure la musique : attendre un album pendant des mois avant sa sortie, aller l’acheter le cœur battant, assister à un concert comme à une cérémonie… Bowie a été l’un des premiers à dire que la musique perdait peu à peu cette dimension.
Je l’admire parce qu’il avait une perception supplémentaire par rapport aux autres : cette aptitude à deviner, à capter son époque par des ondes presque poétiques plutôt que par la sociologie ou l’histoire. Et c’est très rare.
Si vous deviez choisir un seul morceau de Bowie comme bande-son du livre, lequel serait-ce ?
Il y a une chanson, qui n’est pas la plus connue, que j’ai découverte tardivement dans la bande originale du film Lost Highway de David Lynch et qui me frappe par son caractère unique : I’m Deranged. Elle résume bien cette contradiction géniale de Bowie, il incarne mais en même temps il n’est pas dans le personnage. Pour écrire ce morceau, il s’est inspiré de la vie d’un homme interné dans un asile psychiatrique de la banlieue de Vienne, qui créait des œuvres comme forme de thérapie. Bowie avait découvert ses poèmes et s’était reconnu dans cette part de folie. Or, la folie est au cœur de toute l’œuvre de Bowie.
Merci à Michka Assayas de nous avoir accordé cette interview.
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/serie-very-good-trip-david-bowie