Mind the gap : un ticket pour l’Angleterre
Mind the Gap, signé par JD Beauvallet, figure incontournable du journalisme musical, se présente comme un hommage vibrant à la musique britannique et à l’effervescence culturelle qui l’entoure. Oscillant entre récits personnels et exploration passionnée de l’histoire musicale anglaise, cet ouvrage retrace les métamorphoses du rock britannique tout en dévoilant les voyages, rencontres et anecdotes marquantes de son auteur. Bien plus qu’un simple livre sur la musique, Mind the Gap est une déclaration d’amour enflammée à une scène et à un pays qui ont profondément marqué l’imaginaire de générations entières d’auditeurs.

Pour débuter peux-tu nous expliquer ce que veut dire “Mind the gap” ?
C’est le son qui me marque la première fois que j’arrive à Londres. Cette espèce de mantra : “Attention au vide” que l’on entend sans répit dans les stations de métro. Quelqu’un m’explique assez vite que cet avertissement fait référence à l’écart, parfois relativement grand, qui existe entre le métro et le bord du quai, qui est arrondi dans certaines stations.
Ce désir d’aller vivre en Angleterre est-il uniquement porté par ta passion pour la musique ?
Oui, c’est vraiment l’élément déclencheur, et c’est même plus Manchester que l’Angleterre. J’ai une véritable obsession pour cette ville et pour sa scène musicale. Je me dis que je passe à côté de ma vie si je n’y vais pas. En fait, je ne réfléchis pas trop, je n’ai pas le choix, c’est un appel, un ordre. J’étais à un moment de ma vie où je m’étais assez laissé porter par le courant, et là, c’est la première fois que je prends une décision et que je m’y tiens.
Lorsque tu arrives à Manchester, tu es confronté à un monde violent, des conditions de vie exécrables. Tu n’as jamais été tenté de rentrer en France ?
En fait, je me suis interdit de regarder en arrière, de me plaindre. J’avais pris cette décision, et je devais l’assumer. Les fusillades, les bagarres dans la rue, mon logement insalubre, tout cela ne pesait pas bien lourd comparé aux concerts que je voyais à l’Hacienda. Si j’avais un début d’état d’âme, il suffisait que je voie les Cramps ou les Smiths pour être revigoré pour dix ans. J’étais en apprentissage, et il fallait que je le mène à bien.
On a l’impression que tu as vécu le Brexit comme une rupture amoureuse
Ça a vraiment été ça. J’ai pleuré en entendant les résultats, j’étais effondré, parce que c’était effectivement comme une histoire d’amour qui s’amenuise. J’avais l’impression que ma vie était bénie d’une certaine façon. Je ne m’imaginais pas une seule seconde que ce que je prenais pour des acquis, comme la liberté de voyager et de rencontrer des gens, allait être remis en cause de manière aussi violente. Le Brexit, c’était une façon pour l’Angleterre de dire à des gens comme moi : « On t’aime bien, mais un peu moins. » Ce qui est très dur à entendre alors qu’on a l’impression d’avoir fait sa vie ici, d’avoir investi dans cette culture.
Penses-tu que tu pourrais revivre de nos jours les moments que tu décris dans le livre ?
Je ne pense pas que la musique soit aussi centrale dans la vie des gens qui étaient mes compagnons de jeu à Manchester. On était une bande complètement obsédée par la musique ; je pense qu’aujourd’hui elle est beaucoup moins importante dans la vie de tous les jours. Ce serait difficile de vivre des choses aussi intenses et exaltantes. On faisait partie d’un tout, comme le disait Morrissey : “Yeah, you could say we’re a team.” Aujourd’hui, les choses sont beaucoup plus éparpillées, la scène est différente, il y a beaucoup plus de choix de musiques. Ce qui est très exaltant, et en même temps, c’est beaucoup plus difficile de créer une communauté autour de cette musique : elle est moins identifiable.
Tu compares à plusieurs reprises Londres et Paris, et tu n’es pas très tendre avec cette dernière, je te cite : “Je trouve Londres plus belle, plus attirante, plus romantique et plus vivante que Paris. Londres est une muse, Paris est un musée.”
C’est une grosse généralisation, mais quand on évoque la scène parisienne, on a l’impression que ça tourne autour de 50 personnes, alors qu’à Londres, il y a sans arrêt de nouveaux artistes, de nouveaux sons, de nouveaux lieux qui apparaissent quotidiennement. Il y a beaucoup moins ce côté figé, musée à ciel ouvert. Londres est une ville en ébullition permanente, ce qui peut paraître un peu vain, mais au moins, elle permet aux choses d’avancer.
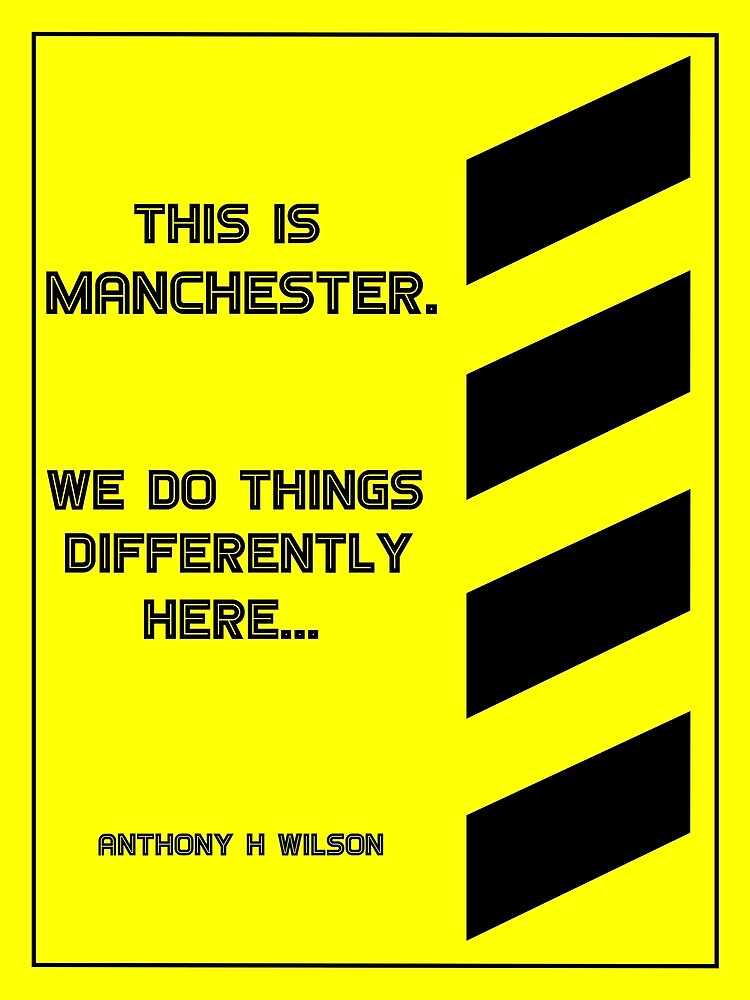
Pour autant, ne penses-tu pas que les grandes villes comme Londres ou Manchester deviennent de plus en plus formatées et perdent peu à peu de leurs spécificités ?
J’étais à Manchester il n’y a pas très longtemps, et je suis tombé sur une affiche dans la rue qui faisait référence à une célèbre affiche de Factory qui disait : “Ici, nous sommes à Manchester, nous faisons les choses différemment.” Et là, il était écrit : “Ici, nous sommes à Manchester, nous faisons les choses exactement comme toutes les autres villes pourries par le capitalisme” (rires). Même Liverpool, qui était une ville avec une identité visuelle et humaine absolument incroyable, rentre un peu dans la norme. Après, ce qui ne change pas — et heureusement — dans ces grandes villes, c’est l’humour et les accents, qui restent les mêmes. C’est plus sur l’aménagement, l’urbanisme, qu’on est en train de passer un peu le rouleau compresseur.
Une phrase m’a particulièrement étonné venant d’un journaliste reconnu pour ses interviews : “Si ça ne tenait qu’à moi, ma première langue serait le silence.”
En fait, tu ne peux pas imaginer à quel point je joue contre ma nature, et je me force à poser la moindre question à un artiste. Ce n’est pas du tout quelque chose de naturel pour moi. Je n’aime rien de plus qu’écouter de la musique dans la nature, isolé par mon casque. Je ne suis pas quelqu’un de très sociable, en fait. Je me suis forcé toute ma vie, parce qu’il fallait bien donner l’illusion. Pour exercer le métier que je voulais, je devais parler aux gens. Quand je faisais des interviews, je n’étais pas moi-même : j’endossais le costume de journaliste et je devenais cette espèce de machine à questions. Mais si je n’ai pas une raison professionnelle d’être là, comme lorsque je me retrouve backstage après un concert, je ne sais vraiment pas quoi dire aux artistes; et comme, souvent, ils sont eux-mêmes un peu timides, ça donne de grands moments de solitude.
En quoi le rapport qu’entretiennent les Anglais avec la musique est-il différent de celui des Français ?
La grande chance des Anglais, c’est de ne pas avoir eu les yéyés. Il y avait des choses passionnantes qui se passaient en France dans les années 60, et les yéyés sont venus ridiculiser et humilier tous les efforts d’artistes un peu plus aventureux. Il y a des chansons chez Nino Ferrer, par exemple, qui sont magnifiques. Ma belle-mère, qui est Anglaise, écoute des disques de Scott Walker chez elle ; pour moi, ça résume assez bien cette différence. En France, on considère comme musique savante des groupes comme Radiohead, Massive Attack ou Björk, alors que c’est le fond commun de la musique chez les Anglais. Pour eux, la pop, c’est quelque chose de central, pour laquelle les gens peuvent s’engueuler. Ils ont aussi cette chance d’être alimentés en musique par les pubs, où les jukebox sont des outils de propagande assez fiables. Ils ont également nourri leur curiosité à travers les radios. La BBC, qui était la radio la plus écoutée d’Angleterre pendant des décennies, diffusait des choses très aventureuses dans les années 60, comme Pink Floyd ou les Who, que l’on n’entendait pas sur RTL. Je n’ai pas l’impression qu’il y ait cette même curiosité en France. Je parle très régulièrement avec des amis anglais qui ont plus de 70 ans et qui continuent d’acheter des disques, d’aller à des concerts, pour qui la musique fait partie de leur ADN, et non un truc qu’on abandonne parce qu’on estime que ce n’est plus de son âge.
Est-ce que la célèbre phrase de Lennon expliquant que le rock français était l’équivalent du vin anglais est toujours d’actualité ?
Ce qui reste vrai, c’est que les Anglais vivent la musique au quotidien de façon plus intime, plus intense que les Français. Mais ce qui a changé, c’est qu’aujourd’hui, tout le monde a les mêmes outils, est sur le même pied d’égalité. À l’époque, les producteurs et les studios étaient toujours de meilleure qualité en Angleterre, alors qu’on faisait avec les moyens du bord en France. Mais ce changement est lent, et c’est toujours un peu extraordinaire quand un groupe français entre dans les charts anglais, alors que l’inverse est tout à fait banal.
Je te cite : “J’ai appris l’Angleterre dans les chansons.” Quels sont les artistes qui, pour toi, racontent le mieux l’Angleterre ?
Des gens capables de faire un scénario de film en trois minutes dans une pop song, il y en a un paquet, que ce soit Elvis Costello, Madness, Morrissey ou Pulp. Ce sont de véritables tranches de vie, racontées à hauteur d’homme, et je trouve ça assez prodigieux de faire tenir autant d’informations dans une chanson. Les Kinks, les Libertines, tous ces groupes qui chantent l’Angleterre viennent d’une certaine façon du music-hall, ce genre qui leur a offert une manière d’écrire des chansons, de raconter de vraies histoires.
Au sujet de la britpop, tu dis que c’est un mouvement presque réactionnaire, qui se contente “d’accommoder les restes”. Que penses-tu de cette frénésie autour de la reformation d’Oasis ?
Ce qui m’étonne surtout en France, c’est que l’on a la nostalgie d’un truc qui n’a jamais vraiment existé, alors qu’en Angleterre, c’était un groupe fondamental des années 90. Je le vois comme une sorte d’hystérie collective à laquelle tout le monde veut participer alors que beaucoup de gens ne connaissent que trois chansons du groupe. C’est un truc rassurant dans une période de troubles, où l’identité même de l’Angleterre est mise à sac. Pour beaucoup de gens, Oasis, c’est un repère, quelque chose de stable, et leurs concerts un passage obligatoire où il faut être sinon tu as raté quelque chose.
On ne ressent aucune nostalgie de ta part dans le livre : c’est le cas ?
Oui, je ne suis pas nostalgique, je cherche toujours à découvrir ce qui va m’exciter. C’est vrai que je ressens beaucoup moins de choses en écoutant du rock ou de la pop aujourd’hui qu’en écoutant du grime, par exemple. J’aime quand la musique sort de ses gonds, c’est pour ça que j’apprécie des artistes comme Pulp ou Damon Albarn, des gens qui sortent de leur pré carré. Être nostalgique, c’est arrêter de chercher, se contenter de ce que l’on a. Beaucoup de gens de mon âge ont abandonné cette quête ; pour moi, je sais qu’elle sera permanente jusqu’à mon lit de mort. Pour prendre un exemple concret, actuellement je suis raide dingue du groupe Salt, et pour moi, ils sont à la hauteur de groupes que j’écoutais dans les années 90.
Pour conclure je voulais savoir si finalement l’Angleterre ne t’avait pas servi de catalyseur pour révéler ce que tu étais profondément ?
C’était une forme assexuée de coming out. L’Angleterre est très tolérante vis-à-vis des comportements situés sur le spectre, notamment des formes plus légères d’autisme. On peut s’y inventer, ou au moins s’y réinventer. C’est comme la Légion : on repart à zéro, on peut même changer de nom. Je suis passé de Jean-Daniel à JD. Ce n’était pas rien pour moi.
Merci à JD Beauvallet de nous avoir accordé cet entretien.
